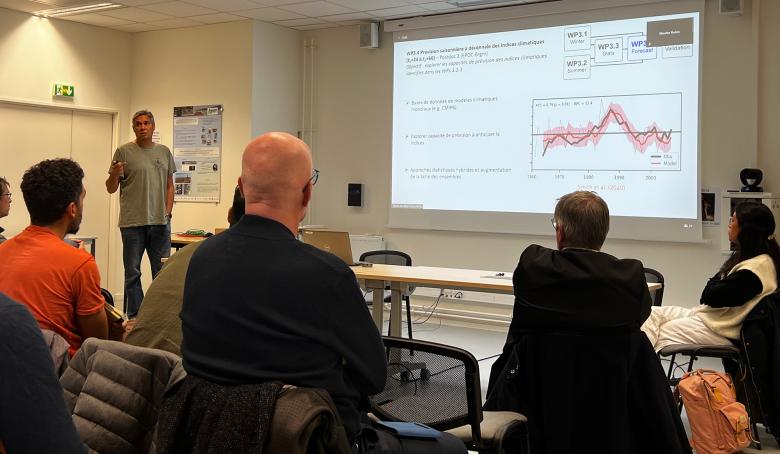Territoires attractifs et vulnérables, les littoraux sont l’objet de dynamiques rapides d'évolution des pratiques sociales, avec des conflits d’usage, et sont confrontés à des aléas d’une ampleur croissante. Ils sont notamment soumis à un phénomène global d’érosion, ainsi qu’à des submersions de plus en plus fréquentes. Une meilleure connaissance des aléas et des risques sur les littoraux est nécessaire pour préparer les sociétés locales aux enjeux liés aux changements globaux.
Or, il existe actuellement plusieurs verrous : la connaissance insuffisante et la modélisation imparfaite des processus et impacts sociaux et physiques empêchent une prédiction et une atténuation des risques d’érosion et de submersion, et les relations entre les échelles intermédiaires et locales restent méconnues.
Dans ce contexte, le projet ciblé IRICOT, coordonné par Aldo Sottolichio (Université de Bordeaux) et Eric David (BRGM) dans le cadre du programme de recherche Risques (IRiMa), vise à répondre à plusieurs objectifs :
- Mieux comprendre et quantifier les processus sociohistoriques
- Mieux comprendre les processus hydrosédimentaires côtiers à l’origine des aléas érosion et submersion
- Améliorer les méthodes permettant de passer de l’échelle régionale à l’échelle locale, où se trouvent les biens exposés
- Intégrer ces avancées dans une évaluation affinée des risques et de la gestion de crise
- Comprendre, formaliser et modéliser la nature changeante des risques multiples et en cascade
- Établir des projections et une cartographie des risques pour tenir compte de ces évolutions.
De l’analyse de la gestion historique des aléas littoraux, au potentiel transformatif de la gouvernance des risques
Le projet est structuré en plusieurs workpackages présentés lors de la réunion de lancement.
1. Analyse sociohistorique de la gestion des risques littoraux et de leurs impacts
Un premier travail vise à produire des connaissances opérationnelles pour l’adaptation, concernant l’évolution des aléas naturels et des effets anthropiques, les territoires dans leur histoire, leur culture du risque et leur évolution physico-socio-économique, tout en tenant compte des savoirs des populations locales.
L’équipe s’attachera à :
- Étudier le rôle des aménagements anthropiques passés dans la propagation des aléas et de leurs impacts aujourd’hui, ainsi que les pratiques anciennes en matière de gestion des risques,
- Co-construire des trajectoires d’adaptation mieux ancrés dans les territoires,
- Améliorer la connaissance de l’aléa submersion marine à travers la modélisation numérique du franchissement lors d’événements extrêmes en zone estuarienne (territoire du Havre), et la diffusion des résultats via un outil de réalité virtuelle augmentée.
Ce travail sera mené en articulation avec d’autres projets du PEPR (Risques NaTech, Plateformes numériques, IRIMONT) et d’autres projets / communautés.

Dégâts sur les maisons causés par l’érosion de la dune à la Tranche-sur-Mer, suite à la tempête Xynthia (Vendée, 2010).
© BRGM - Rodrigo Pedreros
2. Impacts des événements majeurs
Un second workpackage porte sur l’érosion durant les événements de tempête. L’impact des événements extrêmes dans la dynamique long terme de l’érosion est mal connue, or une meilleure compréhension est d’autant plus nécessaire que l’érosion impacte d’autres phénomènes tels que la submersion ou le déclenchement d’instabilités.
L’idée de ce travail est de quantifier ce qui se passe pendant les événements de tempêtes, en se concentrant sur :
- L’érosion des plages sableuses durant les événements énergétiques : le transport hydrodynamique sous l’effet des vagues, et sous l’effet du vent ;
- Le rôle des vagues de tempêtes dans la déstabilisation de pans de falaise.
Trois grandes actions sont prévues : mesurer les processus éoliens le long du profil plage-dune lors des tempêtes ; étudier le devenir des sédiments érodés au niveau des plages lors des tempêtes ; et étudier le rôle de l’impact des vagues sur la déstabilisation de pans de falaises à travers l’acquisition de données, la modélisation et l’intégration de ces connaissances dans un modèle de prévision.
3. Prévisions saisonnières à décennales des risques littoraux
Un troisième travail vise à mieux comprendre, modéliser statistiquement et mieux prévoir un certain nombre d’aléas et indicateurs littoraux. Il couvre différents types de littoraux, à l’échelle des façades littorales atlantiques et méditerranéenne en France métropolitaine.
On observe une très forte variabilité saisonnière et interannuelle des forçages hydroclimatiques, or au cours de 30-40 prochaines années, la variance du signal du trait de côte et ses incertitudes seront en grande partie contrôlées par cette variabilité saisonnière et interannuelle, d’où l’enjeu d’améliorer la prévision à ces échelles.
Ce travail visera à :
- Identifier et diagnostiquer les liens statistiques entre des indices climatiques hivernaux et des indicateurs représentatifs du système littoral, et entre des indices climatiques estivaux et des indicateurs représentatifs du système littoral ;
- Développer et fournir des outils statistiques de prédiction et d’étude de causalité entre les différentes variables ;
- Explorer les capacités de prévision des indices climatiques identifiés ;
- Développer un démonstrateur de services climatiques autour des prévisions saisonnières à décennales des risques littoraux.
4. Solutions d’adaptation face aux risques multiples sur les littoraux
Un dernier workpackage interdisciplinaire, avec une forte composante en sciences humaines et sociales (SHS), vise à travailler sur les solutions d’adaptation, ce qui nécessite de lever trois verrous principaux :
- Dépasser l’approche sectorielle des risques ;
- Améliorer les connaissances sur les conséquences des aléas et risques sur les territoires : en matière de bien-être, de distribution des inégalités, de recompositions territoriales, ou sur le mécanisme assurantiel à l’œuvre, etc. ;
- Interroger le potentiel transformatif de la gouvernance des risques.
La réunion de lancement organisée le 18 novembre à l’Université de Bordeaux fut l’occasion de réunir les membres du projet et de favoriser les échanges sur les différents workpackages pour bien démarrer les travaux de recherche.
IRICOT réunit des spécialistes de la dynamique littorale en sciences de l’environnement (physique, géologie, mécanique des fluides) et en sciences humaines et sociales (histoire, économie, géographie).
Il regroupe 14 acteurs nationaux clés de la recherche sur les risques littoraux : l'Université de Bordeaux (établissement coordinateur), l'Université de La Rochelle, l'Université de Pau et des Pays de l’Adour, l'Université de Poitiers, l'Université de Perpignan, l'Université de Caen, l'Université de Rouen, l'Université de Bretagne Occidentale, INRAE, le CNRS, le BRGM, l'IRSN, Météo France et le CEREMA
En savoir plus :